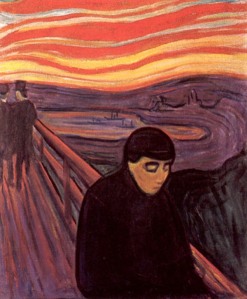
Les forces morales de la France sont paralysées ; les masses se sont retirées de la scène, et l’on se fatiguerait inutilement à chercher le dénouement dans la logique des idées. Quand les drames sont embrouillés à ce point, il n’y a que le deus ex machina qui puisse trouver une issue. C’est un des moments où les peuples sont si las et si désorientés qu’ils laissent à des individus le soin de les sauver. Ce n’est pas qu’il n’y ait de grandes et d’extraordinaires choses à faire, mais les masses n’ont plus l’inspiration de ces choses-là ! Il dépend de quelques hommes de relever et de sauver l’humanité.
Lettre d’Edgar Quinet à son ami Jules Michelet, Bruxelles, 23 novembre 1852
« Las et désorientés ». On ne saurait mieux dire. Collectivement et individuellement, nous sommes las. Et désorientés. Et nous ne pouvons guère compter sur un quelconque deus ex machina pour nous « relever » : il n’existe plus de Clemenceau ni de de Gaulle pour sauver la nation. Nos héros sont des nains ; toute grandeur est depuis longtemps congédiée. Sinistres temps.
Nous subissons, impuissants, les mêmes politiques suicidaires menées depuis des décennies par tous les camps, par tous les partis au pouvoir. L’emballage change à peine, le produit, lui, demeure le même. L’offre politique est à ce point biaisée que les élections sont devenues des mascarades auxquelles plus personne ne croit vraiment – quel que soit le résultat à la sortie des urnes, cela ne change jamais rien : la trahison du referendum de 2005 n’en est que l’exemple le plus éclatant.
Le débat public est volontairement saturé de faux sujets, réduit à un mauvais spectacle conçu afin de ne jamais évoquer la vie « réelle » des gens. Les luttes « sociétales » (le mot est aussi laid que la chose est superficielle) menées pour satisfaire des micro-clientèles électorales effacent opportunément la question sociale qui n’intéresse plus les partis politiques. Le mépris de classe irrigue tout le spectre : même la gauche prétend doctement que les ouvriers et les agriculteurs n’existeraient plus. Quant aux salariés et aux classes moyennes, ils sont priés de faire – et de voter – ce qu’on leur dit sans trop la ramener, s’il vous plaît.
Le peuple ? Ringard ! Ramassis de beaufs !
Le peuple, c’est moche, c’est sale, ça pue, ça pense mal et, surtout, ça vote mal.
La rupture est consommée entre le peuple et les « élites » économiques, politiques, médiatiques. Sarkozy le singeait, son quinquennat a élargi les fractures et abaissé la France. Hollande, qui méprisait les « sans dents », n’a pas même cherché à entendre ses propres électeurs ni à reconstruire les digues abattues par son prédécesseur. Quant à Macron, qui n’a d’yeux que pour les « premiers de cordée », sa « start up nation » a achevé de pulvériser la nation et d’effacer « ceux qui ne sont rien ».
Les laissés-pour-compte de la France périphérique et d’ailleurs, les perdants de la globalisation, les petits, les sans-grades, tous ceux qui ont la bêtise et l’honneur de « jouer le jeu », de ne pas frauder, de ne pas truquer, de ne pas tricher, qui passent à côté de la « mondialisation heureuse », qui n’ont pas l’heur d’appartenir au « cercle de la raison » ni aux mafias religieuses ou criminelles… tout ce petit peuple se sent déraciné de force, abandonné – pire : moqué, raillé, méprisé. Dépossédé de tout pouvoir, de toute voix.
*
À quoi bon voter ? Les élus se fichent du peuple comme d’une guigne et se servent des leurres de la « démocratie participative » et autres gadgets spectaculaires qui confondent le rituel sacré de l’élection en démocratie avec les sondages d’opinion et le clic compulsif de la télé-réalité, pour divertir les masses. Le peuple, lui, a bien conscience que, de toute manière, tout se décide ailleurs. Les échelons démocratiques qui le protégeaient, en qui il avait plus ou moins confiance mais qu’il pouvait identifier et sur lesquels il avait quelque prise, commune et État au premier chef, ont perdu leur pouvoir au profit de structures technocratiques sans aucune légitimité : intercommunalités, régions, Union européenne.
À quoi bon s’engager ? La vertu civique n’a rien d’évident. L’engagement politique, au service de la Cité, demande un effort, fait courir des risques réels. Il y a de la grandeur dans le militantisme – de la grandeur et du courage.
Même de quitter la sécurité protectrice de nos quatre murs et d’entrer dans le domaine public, cela demande du courage, non pas à cause de dangers particuliers qui peuvent nous y attendre, mais parce que nous sommes arrivés dans un domaine où le souci de la vie a perdu sa validité. Le courage libère les hommes de leur souci concernant la vie, au bénéfice de la liberté du monde. Le courage est indispensable parce que, en politique, ce n’est pas la vie mais le monde qui est en jeu. [1]
À quoi bon discuter ? L’entrée dans la lumière de l’espace public devenu archipel d’entre-soi expose à une violence d’autant plus grande que la discussion s’y réduit aux attaques ad hominem, aux intimidations, aux insultes, aux invectives, aux menaces. Toute tentative d’exposition d’une opinion nuancée, d’une argumentation à peine complexe, est vouée à l’échec – perdue dans le silence ou ensevelie sous les immondices de trolls décérébrés. Les imbéciles dominent l’espace public par la loi empirique dite de Brandolini, ou d’asymétrie des idioties : il est beaucoup plus coûteux de démontrer l’inanité de propositions fausses que de les énoncer. Les grands gagnants sont les obscurantistes, les complotistes et les tartuffes de toutes obédiences, qui préfèrent explicitement l’ignorance, les mensonges et la moraline à la raison, à la science et à la responsabilité.
À quoi bon se révolter ? On a beau être camusien, ce que j’ai appelé le « syndrome Batman », cet irrépressible besoin, quand on voit une injustice, de lui sauter dessus pour l’étrangler, vire à la névrose suicidaire qui se gargarise de grandeur, tant le risque est dorénavant certain de se faire planter un coup de couteau parce qu’on a eu l’inconscience de vouloir faire ce que chacun devrait faire.
Alors : pour quoi ? pour rien
Pourquoi se fatiguer ?
Se battre pour le peuple, pour les misérables, pour ceux qui n’en ont pas la force ? Mais que ne le font-ils pas eux-mêmes ! Il y a toujours deux pièges à se vouloir le défenseur de causes qui nous dépassent.
Le premier : chercher dans le combat « altruiste » une rétribution personnelle, même et surtout symbolique. Paternalisme.
Le second : endosser une procuration qui n’est même pas voulue par ceux que l’on pense aider. Ingratitude.
Il est bien plus facile de se battre pour une abstraction, une idéalisation du peuple, des « gens ». Alors que les individus sont toujours vils et veules, lâches et laids. Valent-ils vraiment la peine de se sacrifier pour eux ?
La misanthropie n’est pas une maladie. C’est plutôt une saine réaction épidermique d’autodéfense – se préserver. Le véritable humaniste ne peut qu’être misanthrope : les hommes sont toujours décevants pour celui qui se bat pour l’homme ; pour aimer l’homme, il vaut mieux ne pas côtoyer les hommes ; le contact des congénères ne peut que désespérer du genre humain.
À quoi bon risquer sa vie pour défendre ce en quoi on croit… ou simplement pour faire son métier d’écrivain, de journaliste, de dessinateur ou de professeur [2] ? Quand quelques-uns se lèvent et se battent, montent au front, élèvent les barricades de l’intelligence et, au sommet, se font assassiner par les obscurantistes – que font les autres ? Pour quoi, pour qui sont morts les dessinateurs de Charlie, les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard ? Leurs combats sont-ils voués à l’échec devant la haine et la bêtise ? Combien de martyrs de la liberté, de l’égalité et de la fraternité doivent encore tomber pour que le combat ne soit pas vain ?
À quoi bon vouloir préserver ce qui semble important, vital même, comme la culture, par exemple ? La culture se désagrège sous les attaques de l’avachissement et des idéologies « progressistes ». La culture, tout comme la langue, est conservatrice par définition, Arendt l’a bien montré. Vouloir la préserver vous place dorénavant dans le camp du Mal. Quinet, encore lui :
Le plus grand service que l’on puisse rendre aujourd’hui à la France, c’est de continuer à penser. Sauvez du moins l’esprit français ; s’il survit, le reste ressuscitera. C’est un grand bonheur de s’enfermer dans une œuvre, et de laisser passer ainsi la mauvaise saison. Je jouis de ce bonheur. […] il y a des temps où il faut, pour survivre, se réfugier dans les tombeaux. [3]
« Pour survivre, se réfugier dans les tombeaux ». La perspective est séduisante. Car à quoi bon imaginer protéger le monde qui s’effondre ? Non que je souscrive aux thèses des « collapsologistes » – leur empressement autant que leur gourmandise devant la catastrophe me répugnent. Et puis je les trouve trop naïvement spectaculaires : le désastre véritable n’a pas besoin d’effets spéciaux.
*
Ainsi ne vaut-il mieux pas, en effet, « se réfugier dans les tombeaux » et céder à la tentation crépusculaire de l’Aventin ? Renoncer à la vaine agitation et à l’inutile gloriole d’une noblesse d’âme méprisée par les derniers hommes du Zarathoustra ? Et goûter aux amers délices du suave mari magno ou de la Schadenfreude ?
Parce que, dans la réalité, et contrairement à ce qui se passe dans les contes de fées et surtout dans leurs mauvais ersatz hollywoodiens dont nous nous repaissons l’imaginaire atrophié, ce sont toujours les méchants qui gagnent à la fin : les imbéciles, les crapules et les salauds.
Alors, plutôt que de chercher en vain à sauver ce qui ne peut l’être, plutôt que de crever seul au sommet d’une barricade idéologique en cocu magnifique, je crois que je préfère encore observer le monde disparaître en serrant fort ma fille dans mes bras. Et en lui mentant sciemment lorsque je lui murmure doucement au creux de l’oreille que tout va bien se passer, qu’elle n’a rien à craindre.
Cincinnatus, 20 mai 2024
[1] Hannah Arendt, La Crise de la culture, Folio essais, 1989, p. 203.
[2] Il faut écouter la belle chronique d’Anne Rosencher du 9 mai dernier, à propos de Salman Rushdie et de Charlie Hebdo : « Salman Rushdie, “Le Couteau”, et l’impossibilité d’échapper à la haine ».
[3] Lettre d’Edgar Quinet à Alfred Dumesnil, Bruxelles, 12 octobre 1852.

« Un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d’État pense à la prochaine génération » Clémenceau.
J’aimeJ’aime
Merci pour ce très beau texte, désespéré mais touchant, désespéré mais finalement galvanisant…paradoxalement…non Paty, Bernard, et les dessinateurs de Charlie ne sont pas morts pour rien, tous les apostats de l’islam peuvent en témoigner…
J’aimeAimé par 1 personne