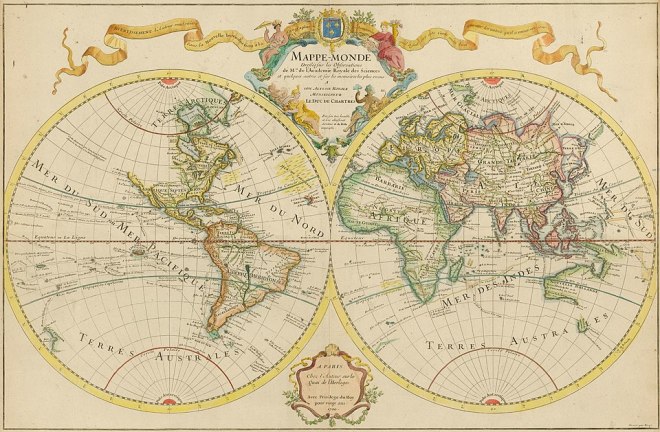
On peut, on doit, remercier, louer, embrasser Donald Trump. On peut, on doit, se réjouir du boulevard gigantesque qu’il ouvre : un boulevard aussi large qu’un chemin de crête, un boulevard aussi sûr que les Champs-Élysées – ceux d’aujourd’hui, bien sûr – après 23h ; oh ! pas la Porte de la Chapelle ni Stalincrack, hein, non : les Champs-Élysées, la « plus belle avenue du monde », n’est-ce pas, – mais de quel monde ? – ; mais un boulevard quand même qu’on aurait tort de ne pas emprunter pour devenir, pour redevenir, pour être encore un peu, encore une fois, une fois seulement, ce phare, cette boussole, ce repère qu’on a été – avant.
Sauf que non.
Sauf qu’on ne le veut pas. Oh ! non ! surtout pas ! On ne veut surtout pas le prendre ce boulevard, l’emprunter ce chemin de crête, l’endosser ce rôle, de composition maintenant, surtout pas l’interpréter ce jeu de rôle, surtout pas composer pour s’enrôler involontairement, contre la volonté – générale ? –, surtout pas assumer, assurer d’être un pays symbolique dans l’imaginaire des peuples, un pays qui suscite l’admiration, un pays qui inspire les peuples opprimés – non : on préfère s’inventer des opprimés sur-mesure.
On ne lit pas Marc Bloch, on le panthéonise, c’est plus commode, c’est plus pratique – on ne lit pas, on ne lit plus Marc Bloch, à propos de l’esprit français, à propos de la France : « Le culte de la patrie et l’exécration des tyrans », c’est fini. Bien sûr.
C’est fini.
Fini, aussi, l’universalisme, la générosité universelle, le refuge pour ceux qui rêvent d’émancipation.
Fini, aussi, « une certaine idée ». Faute d’être alimentée, cette image de la France devient un souvenir. Et un souvenir, ce n’est déjà plus grand-chose, déjà plus rien. On refuse, c’est plus commode, c’est plus pratique, de voir la charge symbolique de la France dans les imaginaires étrangers. On en est gêné. On s’en excuse sans même chercher à la comprendre. On abdique, on capitule, on redditionne ; on n’a même pas à combattre, la défaite n’a rien d’étrange. On présente soi-même la gorge au couteau. On abandonne. Avec soulagement. Avec un soulagement certain. Avec un soulagement voluptueux. On abandonne ; on s’abandonne. Rentrer dans le rang, à tout prix, à tout crin, atout cœur – et on s’excuse.
On s’excuse presque que ce ne soit qu’aujourd’hui, que ce ne soit pas hier, qu’on n’ait pas été plus tôt ce qu’on est sans doute trop tard : rien. Ou pas grand-chose. Insignifiant. Pardon, on ne fait que passer. Aux autres la direction ! Aux autres la décision ! On s’illusionne vivre pas trop mal en tant que troisième banlieue de New York ou de Pékin. La France est devenue une banlieue du monde. Banlieue dortoir, cité sans âme. À la traîne. À la ramasse. Sénilité d’un peuple trop vieux d’une nation trop vieille, percluse de rhumatismes à l’âme. Une nation, un peuple impotent, impuissant, incontinent. C’est terrible la dépendance. Surtout quand elle est volontaire, voulue, choisie, programmée, décidée. On est dépendant des autres, des puissants ou des demi-puissants, de tous ceux n’ont pas renoncé, eux. Peut-être n’ont-ils pas assez de volonté, de courage pour renoncer.
On se dit ça.
Ça et d’autres choses encore.
Pour se rassurer. Pour se consoler. Pour s’apprivoiser et accepter de vivre avec soi-même, une fois qu’on a renoncé.
On vilipende, on conspue, on méprise… on ignore – c’est pire encore – ce qui fut une fierté, devenue trop gênante, trop inconfortable, trop large, trop grande pour un corps qui a tant rétréci, pour un corps si rabougri : la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, l’autre nom de la démocratie – réduite à un vieux vêtement mité, à une vieille guipure passée de mode dont il ne faut que se débarrasser au plus vite, au plus tôt. Obsolète. Surannée.
On se complaît dans la vassalisation, on l’accueille avec une sorte de plaisir presque innocent – presque seulement : l’innocence est toujours suspecte. On ne souffre même pas, on ne ressent même pas d’indigestion de chapeaux, de couleuvres, de tout ce qu’on peut avaler, de tout ce qu’on doit avaler, de tout ce qu’on demande soi-même à avaler. On se réjouit bruyamment d’être le terrain de jeu de tous les régimes vraiment ennemis ou faussement amis, de toutes les manipulations extérieures, de toutes les déstabilisations étrangères par tous les moyens, par tous les réseaux, y compris soi-disant sociaux – merci tiktok –, d’être à la remorque des autres, de l’Algérie, de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de l’Iran, de la Russie, de la Turquie (par ordre alphabétique !), de n’importe qui, de tout le monde, de tous les autres, de tous ceux qui veulent prendre la direction des opérations.
Mais être soi-même aux commandes de son propre destin ? surtout pas, malheureux ! On préfère se réfugier sur le siège passager, mieux : sur le siège enfant à l’arrière, recroquevillé, bien attaché, bien ligoté – ou dans le coffre, encore mieux, encore mieux le coffre !, plus sûr pour être sûr de ne rien voir, de ne rien faire –, le plus loin possible des parents, le plus loin possible des grandes personnes, le plus loin possible de ceux qui décident, le plus loin possible de ceux qui pendant ce temps se partagent le monde.
On s’infantilise soi-même.
On élit un Président comme nous, un Président-enfant. Un Président-sourire-colgate, un Président-Kennedy-du-pauvre avec un demi-siècle de retard ; un Président risée du monde, du monde qui se marre, qui se gausse, qui se fout de ses rodomontades de matamore de troisième classe. On n’a même pas la force, on n’a même pas le courage, on n’a même pas la ténacité pour s’en offusquer, pour réagir. On regarde le monde du dehors, le dehors d’un magasin, à travers la vitrine du magasin, avec une sorte d’envie d’entrer et de ne surtout pas entrer. En être et ne pas en être.
On se flagelle, on se félicite de chaque humiliation – encore, oh oui ! fais-moi mal encore ! Au premier chef – dans tous les sens du terme – : le couple franco-allemand qui n’a jamais existé que dans l’esprit des traîtres – c’est-à-dire de tout ce qui respire – est un couple sadomasochiste. On observe avec dégoût et ravissement, on observe avec envie et contentement notre meilleur ami mener sa politique de puissance contre tous les intérêts de la France et de l’Europe, on admire et on se félicite de la sape assumée de l’économie de la France, de sa politique énergétique depuis des années – on y met même la main soi-même, même pas mal, même pas peur : sous les encouragements unanimes des spectateurs hilares, on coupe, on taille, on racle, on détruit tout ce qui pourrait faire de l’ombre à notre ombrageux voisin et néanmoins ami, n’est-ce pas ? N’est-ce pas.
Après qu’on a sabré, après qu’on a suicidé notre filière nucléaire pour lui complaire, on songe à partager avec lui, on songe à lui céder même – pourquoi pas ? – notre siège au Conseil de sécurité de l’ONU ; et puis notre Défense, et puis notre armée, et puis notre sécurité, et puis notre souveraineté. Ce n’est plus un complexe d’infériorité, ce n’est plus un syndrome de Stockholm pour Berlin, on atteint les abîmes de la veulerie et on continue de creuser.
On peut même, on doit même, remercier, louer, embrasser notre meilleur ami d’outre-Rhin pour avoir menacé l’Algérie, notre meilleur ennemi d’outre-Méditerranée, et fait libérer Boualem Sansal – autrement, sans l’Allemagne, si on n’avait compté que sur notre Président-enfant-sourire-colgate-Kennedy-matamore, sur nos dirigeants, sur notre diplomatie, sur notre aura, sur notre puissance, sur notre crédibilité, sur notre capacité à imposer des rapports de force, on n’aurait récupéré que des os, et encore depuis longtemps blanchis à l’obscure lumière des geôles algériennes. On élit des dirigeants, on élit des gouvernants qui sont incapables de sortir un écrivain des geôles algériennes sans demander à d’autres de le faire pour eux. On se couche, on s’écrase, on s’efface. On élit des dirigeants, on élit des gouvernants prêts à toutes les compromissions, prêts à trahir – comme tout ce qui respire – prêts à vendre le pays à ses ennemis ; mais incapables de sortir un écrivain des geôles algériennes sans demander à d’autres de le faire pour eux. Il y a cohérence.
On peut s’en féliciter, on peut s’en rengorger, on peut s’en réjouir. Il y a cohérence.
On se croit très fort à refuser la désignation de l’ennemi, à refuser de se défendre, à refuser d’assumer l’honneur d’être une cible. On fait comme les autres. Exactement comme les autres qui se laissent attaquer et disent encore merci à ceux qui les massacrent. On préfère se faire massacrer qu’être les seuls à se défendre. Kalachnikovs et grenades contre nounours et bougies. Gloire supérieure ! Alléluia ! On est aussi con que les autres. Champagne !
On parlait haut, on parlait fort ; on se tait. On était entendu, on était écouté, on était attendu, on était craint ; on est simplement… ignoré. On a honte de soi, on a honte de ce qu’on fit, de ce qu’on fut. On n’a même plus le cran, l’audace d’être des clowns lyriques.
On méprisait avec superbe le pognon, le vil fric, la thune corruptrice – ça tombe bien : du flouze, il n’y en a plus – la corruption, elle, demeure… mais peu importe ! On a les veaux plaqués or qu’on peut se permettre. On révère le Saint-Marché et on achève le Diable-État ; aux oubliettes, le vieil État-nation, indéfendable, bouc-émissaire fort pratique de toutes les abdications, de toutes les capitulations, de toutes les redditions. On fait comme tout le monde : on se vend, on se livre, on se donne, on s’offre volontiers, tout entier au dieu-Argent.
Et, en même temps, on s’esclaffe, on se papouille, on se paluche devant l’appauvrissement général, devant l’appauvrissement relatif, devant l’appauvrissement absolu, devant le décrochage national, devant la dégringolade internationale, devant le déclin – mais non, voyons ! nenni, vous dis-je ! point de déclin, que des déclinistes ! On ne s’appauvrit pas, on ne décroche point, on ne dégringole rien, on ne décline guère !
Certes, on n’aime plus baiser, on préfère biaiser. La démographie débande. On croît moins, on croit plus. Vive le puritanisme mahométo-calviniste ! On se soupçonne, on s’observe, on se suspecte, on se délationne – on se joue une guéguerre de chacun contre tous, de chacune contre toutes – il faut bien être inclusif et haïr toutes-et-tous comme l’exige le catéchisme puritain, aussi bêtement bêlant qu’il soit au nom de God ou d’Allah. On était le pays de la sensualité, de la galanterie, de la séduction dans tout ce que cela a d’intelligence et de jeu, de jeu intelligent, d’intelligence ludique, d’humour, de finesse, de subtilité, de nuances. On lance un dernier adieu au libertinage érotique et philosophique – donc éminemment politique ! À l’alliance inouïe de la poésie et du cul. De la gaudriole et de la métaphysique.
L’esprit français, l’esprit de légèreté est mort. À l’esprit frondeur de nos aînés, on a consciencieusement substitué l’esprit suiveur. L’irrévérence a vécu ; l’irréligion, l’anticléricalisme, le blasphème sont vaincus ; poil au… On ne se moque plus des corbaques, on ne titille plus les nonettes, on ne bouffe plus les curés : on préfère sucer les imams. On génuflexie devant les linceuls fétides qui recouvrent les femmes et les fillettes ; on se prosterne devant les barbus à babouches, devant les Hibernatus moyenâgeux, devant les assassins et les croque-morts. On jette aux orties, on diffame, on calomnie, pire : on ignore cette laïcité qui, encore, distingue la France parmi les nations.
Distinguait, pardon, ça fera trois pater : à consommer sur place ou à emporter ?
La laïcité : distinction si importune, si ennuyeuse. Distinction si historique. Pouah ! L’Histoire, le passé, la culture, la transmission : table rase, les amis ! Table rase ! Une nation littéraire à l’heure de netflix ? Diantre, quel anachronisme ! Un « art de vivre à la française » à l’heure des réseaux soi-disant sociaux ? Fichtre, quelle absurdité ! Un art de vivre – un art tout court qui fait long feu.
On se pince le nez devant la beauté qu’on ne sait plus reconnaître, qu’on ne veut plus connaître. On voue un culte barbare au moche, au vulgaire, au répugnant, érigés en idoles. On s’extasie, on se pâme, on se congratule une coupe de mauvais champagne dans la main, l’autre sur le portefeuille – ne tentez pas les pickpockets ! –, devant les productions excrémentielles, devant les furoncles égotiques, devant les escroqueries boursouflées de l’art contemporain international, plus contemporain qu’art. On s’esbaudit, on applaudit, on s’enthousiasme devant Paris, plus belle ville du monde devenue plus belle capitale du Tiers-Monde.
On renonce à l’insouciance en même temps qu’à la conscience aiguë du prix de la vie. Et on renonce à la grandeur. Sous toutes ses formes – même les plus petites, même les plus minuscules, même. La grandeur, on ne la conjugue plus qu’au passé. Donc au néant. On troque, on a troqué la sublime arrogance, la morgue légitime envers tout ce qui est petit, envers tout ce qui est minable, on les a troquées contre tout ce qui est petit, contre tout ce qui est minable. Renversant !
Finie, disparue, effacée, enterrée, muerta, dead, la « vieille collectivité, cimentée par des siècles de civilisation commune », comme l’appelle douloureusement Marc Bloch, encore lui. D’une nation d’idées et d’idéaux, on devient une destination touristique de masse, la cour de récré des autres, un centre de loisirs, le hideux rejeton de Disneyland avec un Club Med – et on dit merci !
Certains ont la folie des grandeurs, on a la folie de la petitesse. Chacun fait selon ses moyens, n’est-ce pas ? N’est-ce pas.
On en vient à se haïr soi-même, à se conchier soi-même, à se meurtrir soi-même, à se confire dans l’autocritique comme on se régale à se suçoter l’aphte. On se fait de soi-même son propre bourreau, l’Héautontimorouménos, on n’aime rien plus que se détester : les Français, la France, tout est à jeter par-dessus tous les bords. Au diable ! À l’échafaud ! À mort ! On savoure ce goût de sang au fond de la bouche, même et surtout si c’est son propre sang, son propre goût. Miam.
On s’abhorre si bien qu’on n’ose même plus écrire, encore moins parler, déclamer, réciter, chanter sa propre langue, la langue française qui fut la langue des Princes et des Grands, de la diplomatie, des négociations et décisions qui ont changé la face du monde, la langue de la liberté, on parlait la liberté en français, on chantait la Marseillaise, les Peuples et les Petits chantaient la Marseillaise partout où la liberté était battue, rabattue, écrasée, massacrée, la Marseillaise dont on ne comprend même plus les paroles, et on s’en fiche – qu’importe ?
On ne parle plus en français, on préfère pérorer dans un jargon chic et con, dans un volapük vaguement anglicisant, aussi approximatif qu’aléatoire, pour mieux rentrer dans le moule, pour faire bien, pour faire snob ; on envahit l’espace public de pubs privées, d’affiches, de slogans, d’enseignes, d’imprécations, de supplications, dans ce franglish détestable qu’on ne saisit même pas mais qu’on fait mine de maîtriser ; on ignore sa propre langue et on déblatère aussi mal l’anglais que le français. Snobisme de précieux ridicules. Mais, au moins, « on se comprend », aime-t-on à croire.
Mais, au moins, on s’imagine de la même eau que les autres, de la même inculture que les autres. La distinction dans l’indistinct. On n’est plus français – ou on ne le paraît plus – c’est ça l’important – c’est ça qui compte – or, compter, c’est tout ce qui compte – même si on est nul en math. Alors on triche, on simule, on paraît. On fait la moue, on pince les lèvres, on cligne de l’œil ; on se reconnaît ainsi : entre soi.
Entre-soi.
On s’assure, on se rassure, on se plie en quelques, on se contorsionne pour mieux rentrer dans la petite boîte qu’on a fabriquée par avance, on colle la bonne étiquette et emballé, c’est pesé ! Chacun dans sa boîte. Et les boîtes sont bien rangées. Chacun est bien rangé où il doit l’être, où il doit être. On creuse, on creuse, on creuse les tranchées dans une trop vieille nation, on aggrave les fractures ; on se perd dans une guerre des sexes, dans des luttes des races, produits d’importation – encore, toujours. On sclérose les identités, on se déteste, soi et les autres, les autres comme soi, misanthropie bien ordonnée commence par soi-même et termine par les autres :
l’abjection que l’autre suscite n’a d’égal que l’horreur que l’on s’inspire à soi-même – évangile selon Cincinnatus.
Seules subsistent les identités pétrifiées, monolithiques, figées, paranoïaques, obsidionales. Calquées sur les modèles étrangers – bien sûr : on se délecte des importations idéologiques tout droit venues des campus américains, des campus anglais : on a fait des universités les succursales misérables de ces campus américains, de ces campus anglais dévorés par l’idéologie, dont on reprend le pire de là-bas en laissant tomber l’excellence d’ici, en laissant tomber l’universalisme d’ici – on éteint les Lumières : vive l’obscurité, vive l’obscurantisme.
Comme dans tous les domaines, le label « vu à l’étranger » y vaut bien plus que le « made in France » même si ce dernier est déjà en anglais. Alors on copie et ça colle. Ça pègue. On ne s’inspire même pas – trop fatigant – on imite, on singe, on se fait faussaire pour la bonne cause : ressembler au reste du monde, se grimer en reste du monde, se faire soi-même encore plus reste du monde que le reste du monde.
Alors on gomme, on efface, on supprime, toutes les originalités. Tout ce qui dépasse, tout ce qui affleure, tout ce qui suggère une velléité d’honneur, une ambition de dignité, un rêve de grandeur, une espérance d’excellence – tous ces machins encombrants, tout doit disparaître ! Au lieu de s’enorgueillir de sa solitude, on en a honte et on choisit de se trahir soi-même pour mieux rentrer dans le rang. On débranche ce qui reste de cortex au milieu des nouilles trop cuites qui occupent l’espace vide entre les deux oreilles. On préfère l’unanimité dans l’erreur et le mensonge plutôt que la solitude dans la vérité. Question de confort. D’avachissement. De lassitude généralisée d’être une nation originale. On se laisse aller aux envies de défaites. De rejoindre le flot moutonnier. De s’oublier dans la masse. On ne manque pas de volonté : elle est toute dirigée contre elle-même – on ne veut pas vouloir. Ouroboros postmoderne.
On se complaît dans un funeste rétrécissement de l’horizon, dans la morne euphorie de la commune médiocrité.
Par paresse ?
Peut-être.
Par étroitesse d’âme ?
Sans doute.
On se contente, on se satisfait de ces aspirations à hauteur de caniche. Les conforts du présent bornent les regards, atrophient les imaginations et lestent les aspirations. On est si bien, à n’être surtout pas ce qu’on a été et qu’on aurait pu être, qu’on pourrait être, qu’on devrait être.
Non : être comme les autres.
L’herbe est plus moisie de l’autre côté de la barrière mais tant pis, tant mieux, tout ce qui est étranger est plus précieux. On aime moins son prochain que son lointain – Nietzsche en perd son latin et Zarathoustra remonte dans sa montagne : les derniers hommes ne méritent pas son étoile qui danse. On lui préfère la dernière série netflix, on lui préfère le repas deliveroo, on lui préfère le chauffeur uber, on lui préfère le cul in vitro par porno interposé, on lui préfère, sur un hémisphère et demi, la culture de l’avachissement.
On crève de niaiserie. Entre deux vidéos, l’une abjecte et l’autre débile – tout au même niveau.
On crève la gueule ouverte dans le caniveau de la société de l’obscène qui arase tout, qui formate tout, qui aplatit la planète et qui assure le service après-vente de toutes les révolutions : rendre tous et chacun aussi égal que possible – mais égalité dans la stupidité et l’ignoble, dans la servilité et la bassesse. L’humanité revenue au stade de la paramécie – la boucle est bouclée. On s’extasie dans la communion universelle d’un orgasme vide et triste. On est décidément un con.
Cincinnatus, 17 novembre 2025

Bonsoir,
J’ai tout lu et bien sûr comme toujours même si je partage l’idée générale, c’est dans le « détail » que je serais plus nuancé…
Effectivement j’ai l’impression que nous croyons de moins en moins en nous et que cet état d’esprit nous fait glisser lentement mais régulièrement vers une forme de bassesse en bien des choses.
Eviter cela demande du travail, du courage mais aussi l’acceptation de certains inconforts (matériels et spirituels… ).
Dans nos vies somme toute bourgeoises, que sommes nous prêts à endurer?
Je vous souhaite, par anticipation, une bonne année!
Pierre
J’aimeJ’aime